

"L'erreur du cinéma, c'est le scénario." (Fernand Léger)
Laurent Boutonnat est décidément un réalisateur insaisissable,
tournant des clips insaisissables. Après son retour derrière la caméra pour
filme r Mylène Farmer dans Les
Mots, le cinéaste montre plus que jamais que ce sont ses muses qui
s'adaptent à son cinéma et pas l'inverse. Alors que tout le monde attendait le
retour de Mylène Farmer devant la caméra interprétant des personnages, grimée
et surexploitée, Boutonnat se fond de plus en plus dans l'intimisme qu'il
semble ne plus quitter depuis les clips de Nathalie Cardone de 1997-1998 :
Laurent Boutonnat a changé, finies les grosses productions. Qu'il filme telle
ou telle artiste, sa direction restera la même (Moi... Lolita formant
une exception que nous détaillons à la rubrique correspondante). Mais
justement quelle est cette direction ?
r Mylène Farmer dans Les
Mots, le cinéaste montre plus que jamais que ce sont ses muses qui
s'adaptent à son cinéma et pas l'inverse. Alors que tout le monde attendait le
retour de Mylène Farmer devant la caméra interprétant des personnages, grimée
et surexploitée, Boutonnat se fond de plus en plus dans l'intimisme qu'il
semble ne plus quitter depuis les clips de Nathalie Cardone de 1997-1998 :
Laurent Boutonnat a changé, finies les grosses productions. Qu'il filme telle
ou telle artiste, sa direction restera la même (Moi... Lolita formant
une exception que nous détaillons à la rubrique correspondante). Mais
justement quelle est cette direction ?
 Autant le dire, pour n'importe quel public ayant vécu le doux enthousiasme que
chaque nouvelle sortie de clip suscitait jusqu'en 1992, Pardonne-moi ne
peut-être que décevant. Tout ce qui faisait de chaque clip un oeuvre de
divertissement à part entière disparaît ici : plus de figurants, ni de
personnages, ni de dialogues, ni d'action. La question la plus évidente alors
à se poser est de savoir ce qu'il y a à gagner à se défaire de tout cela ? On
remarque justement que tout ce que Boutonnat supprime depuis Mon ange (1998)
a trait à la narration, au fait de s'attacher à d'autres structure que celle
de l'image et de son discours. Fernand Léger disait que "l'erreur du
cinéma, c'est le scénario". La solution du problème se trouve
peut-être bel et bien ici : Laurent Boutonnat serait-il moins cinéaste
Autant le dire, pour n'importe quel public ayant vécu le doux enthousiasme que
chaque nouvelle sortie de clip suscitait jusqu'en 1992, Pardonne-moi ne
peut-être que décevant. Tout ce qui faisait de chaque clip un oeuvre de
divertissement à part entière disparaît ici : plus de figurants, ni de
personnages, ni de dialogues, ni d'action. La question la plus évidente alors
à se poser est de savoir ce qu'il y a à gagner à se défaire de tout cela ? On
remarque justement que tout ce que Boutonnat supprime depuis Mon ange (1998)
a trait à la narration, au fait de s'attacher à d'autres structure que celle
de l'image et de son discours. Fernand Léger disait que "l'erreur du
cinéma, c'est le scénario". La solution du problème se trouve
peut-être bel et bien ici : Laurent Boutonnat serait-il moins cinéaste qu'avant parce qu'il ne s'attache plus au narratif, dans le sens diégétique tu
terme ? Ceci expliquerait pourtant l'absence de troisième long-métrage après Ballade
de la féconductrice et Giorgino. Pourquoi faire un long-métrage en
s'encombrant de contraintes facultatives (dont l'histoire) alors que seule
l'image compte ? On peut bien sûr tergiverser sur le bien fondé de cette
démarche; mais si on peut critiquer volontiers Pardonne-moi sur le
divertissement et l'ambition, on ne peut lui reprocher son manque d'images.
qu'avant parce qu'il ne s'attache plus au narratif, dans le sens diégétique tu
terme ? Ceci expliquerait pourtant l'absence de troisième long-métrage après Ballade
de la féconductrice et Giorgino. Pourquoi faire un long-métrage en
s'encombrant de contraintes facultatives (dont l'histoire) alors que seule
l'image compte ? On peut bien sûr tergiverser sur le bien fondé de cette
démarche; mais si on peut critiquer volontiers Pardonne-moi sur le
divertissement et l'ambition, on ne peut lui reprocher son manque d'images.

Depuis le début de sa carrière, le
vocabulaire de Laurent Boutonnat reste en tout cas d'une implacable cohérence.
Dans Pardonne-moi il va même jusqu'à reproduire en grande partie les cadrages
de Maman à tort, comme si ce coup d'essai datant de février 1984 n'en
était pas un et que tout avait été pensé, réfléchi, approuvé et que tout
était resté inamovible. La répétition des zooms avants sur le visage sont les mêmes, et cette silhouette à robe courte à demi dans
l'obscurité qui avance face à la caméra est toujours la même, c'est la
(finalement) fidèle Mylène Farmer 17 ans après, reproduisant la même
démarche, devant la même caméra, sous les mêmes lumières, devant le même
oeil de cinéaste amoureux. Bien sûr l'image, elle, a évolué, Laurent
Boutonnat n'arrêtera jamais d'apprendre, offrant d'année en année des images
de plus en plus rares, mais de plus en plus sublimes. Mêmes les clips les plus
récents confortent la vision de Laurent Boutonnat comme un auteur, si par
exemple ses légères contre-plongées de trois quart gauche lui sont depuis de
nombreuses années reconnaissables, certains de ses jeux de lumières
appartiennent à lui seul. En plus de l'atmosphère si personnelle qu'il
distille dans chacune de ses oeuvres, on peut en effet reconnaître sa
disposition complexe de ce qu'on appelle en cinéma "la photographie".
Le projecteur qui est situé derrière en hauteur du sujet filmé est utilisé
dans la totalité
visage sont les mêmes, et cette silhouette à robe courte à demi dans
l'obscurité qui avance face à la caméra est toujours la même, c'est la
(finalement) fidèle Mylène Farmer 17 ans après, reproduisant la même
démarche, devant la même caméra, sous les mêmes lumières, devant le même
oeil de cinéaste amoureux. Bien sûr l'image, elle, a évolué, Laurent
Boutonnat n'arrêtera jamais d'apprendre, offrant d'année en année des images
de plus en plus rares, mais de plus en plus sublimes. Mêmes les clips les plus
récents confortent la vision de Laurent Boutonnat comme un auteur, si par
exemple ses légères contre-plongées de trois quart gauche lui sont depuis de
nombreuses années reconnaissables, certains de ses jeux de lumières
appartiennent à lui seul. En plus de l'atmosphère si personnelle qu'il
distille dans chacune de ses oeuvres, on peut en effet reconnaître sa
disposition complexe de ce qu'on appelle en cinéma "la photographie".
Le projecteur qui est situé derrière en hauteur du sujet filmé est utilisé
dans la totalité 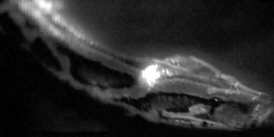 des cas
comme une lumière d'appoint pour esquisser très légèrement par exemple le
contour d'une chevelure en l'éclairant par derrière. Ce projecteur est mis
très en évidence dans le cinéma de Laurent Boutonnat, qui le pousse au
maximum de sa puissance, et l'avance plus à la verticale au dessus du sujet.
C'est cette astuce inédite au cinéma (ou utilisé très parcimonieusement) qui
laisse apparaître notamment le front et le nez de Nathalie Cardone en les
illuminant lorsqu'elle se meut sur Mon Ange, qui fait étinceler la
crinière du cheval de Pardonne-moi et briller le long corps du
serpent jusqu'à le teinter en blanc; c'est aussi ce projecteur
omniprésent qui auréole la coiffure de la grande majorité des personnages de
Laurent Boutonnat lorsqu'ils sont sur un fond obscure de studio (Alizée dans Moi
Lolita, Mylène Farmer dans Beyond my control...)
des cas
comme une lumière d'appoint pour esquisser très légèrement par exemple le
contour d'une chevelure en l'éclairant par derrière. Ce projecteur est mis
très en évidence dans le cinéma de Laurent Boutonnat, qui le pousse au
maximum de sa puissance, et l'avance plus à la verticale au dessus du sujet.
C'est cette astuce inédite au cinéma (ou utilisé très parcimonieusement) qui
laisse apparaître notamment le front et le nez de Nathalie Cardone en les
illuminant lorsqu'elle se meut sur Mon Ange, qui fait étinceler la
crinière du cheval de Pardonne-moi et briller le long corps du
serpent jusqu'à le teinter en blanc; c'est aussi ce projecteur
omniprésent qui auréole la coiffure de la grande majorité des personnages de
Laurent Boutonnat lorsqu'ils sont sur un fond obscure de studio (Alizée dans Moi
Lolita, Mylène Farmer dans Beyond my control...)

 Certains seront peut-être déçus de ne pas voir apparaître ici d'analyse
symbolique, pragmatique, énonciative ou même syntagmatique. Mais les clips de
Laurent Boutonnat ne s'y prêtent plus. Laurent Boutonnat ne raconte plus (mis
à part les clips réalisés pour Alizée, quelques maigres "histoires prétextes"
comme celle de Les Mots et d'éventuels futurs clips diégétisés). Il
serait en effet totalement vain de chercher les sous-traitances avec les paroles
de la chanson, de trouver la fonction de l'homme à cheval, du serpent, ou de la
poussière. La seule chose analysable dans Pardonne-moi est son
réalisateur, ses goûts pour les images syncopées, l'esthétique à tout prix,
et les ambiances inédites (amusez-vous à trouver quelle autre oeuvre
audiovisuelle peut provoquer en vous le même genre de sensation que le clip de Pardonne-moi,
et les clips de Laurent Boutonnat depuis 1998 en général...)
Certains seront peut-être déçus de ne pas voir apparaître ici d'analyse
symbolique, pragmatique, énonciative ou même syntagmatique. Mais les clips de
Laurent Boutonnat ne s'y prêtent plus. Laurent Boutonnat ne raconte plus (mis
à part les clips réalisés pour Alizée, quelques maigres "histoires prétextes"
comme celle de Les Mots et d'éventuels futurs clips diégétisés). Il
serait en effet totalement vain de chercher les sous-traitances avec les paroles
de la chanson, de trouver la fonction de l'homme à cheval, du serpent, ou de la
poussière. La seule chose analysable dans Pardonne-moi est son
réalisateur, ses goûts pour les images syncopées, l'esthétique à tout prix,
et les ambiances inédites (amusez-vous à trouver quelle autre oeuvre
audiovisuelle peut provoquer en vous le même genre de sensation que le clip de Pardonne-moi,
et les clips de Laurent Boutonnat depuis 1998 en général...)  Si
les éléments que choisi Laurent Boutonnat pour chaque nouveau clip rappelle
les anciens, il apporte en outre à chaque fois un élément qui vient enrichir
ce qu'il avait déjà mis en place et qui présente l'interprète sous un jour
à chaque fois un peu différent. Dans cette optique, l'image la plus frappante
n'est pas celle des yeux blancs, ou noirs (simple effet de frayeur par l'emploi
des sensations descendantes) mais cette espèce de danse tribale au ralenti et
au noir et blanc très contrasté et granulé, avec une Mylène Famer qu'on
imagine plongée dans la poussière de l'au-delà. Sur un fond très noir, les
particules de ce
Si
les éléments que choisi Laurent Boutonnat pour chaque nouveau clip rappelle
les anciens, il apporte en outre à chaque fois un élément qui vient enrichir
ce qu'il avait déjà mis en place et qui présente l'interprète sous un jour
à chaque fois un peu différent. Dans cette optique, l'image la plus frappante
n'est pas celle des yeux blancs, ou noirs (simple effet de frayeur par l'emploi
des sensations descendantes) mais cette espèce de danse tribale au ralenti et
au noir et blanc très contrasté et granulé, avec une Mylène Famer qu'on
imagine plongée dans la poussière de l'au-delà. Sur un fond très noir, les
particules de ce ndres
s'échappent des cheveux et donnent à la silhouette de la chanteuse en la
suivant la très étrange allure d'un spectre. Dans ces plans magnifiques, l'interprète
reste les yeux fermés, totalement inexpressive, comme si quelque chose de
surhumain la guidait, l'avait sortie de la poussière où elle reposait depuis
la nuit des temps. Seuls deux plans quasi-subliminaux surexposés la montreront
hilare, la tête basculée en arrière, rendant du même coup l'ensemble de la
danse et du clip dénués de sens et de logique. Reste ce chevalier mystérieux,
lui aussi sur fond noir, qui galope sans fin et qui rythme la chanson. On peut
sur ce point remarquer deux choses : Ses apparitions se font à des moments de
la chanson où la répétition est aussi musicale, ce qui accroît l'idée d'un
galop sans fin du cheval et la course de ce prince qui jamais n'arrivera à
destination. Pour renforcer cette idée on peut remarquer aussi que le cheval
ndres
s'échappent des cheveux et donnent à la silhouette de la chanteuse en la
suivant la très étrange allure d'un spectre. Dans ces plans magnifiques, l'interprète
reste les yeux fermés, totalement inexpressive, comme si quelque chose de
surhumain la guidait, l'avait sortie de la poussière où elle reposait depuis
la nuit des temps. Seuls deux plans quasi-subliminaux surexposés la montreront
hilare, la tête basculée en arrière, rendant du même coup l'ensemble de la
danse et du clip dénués de sens et de logique. Reste ce chevalier mystérieux,
lui aussi sur fond noir, qui galope sans fin et qui rythme la chanson. On peut
sur ce point remarquer deux choses : Ses apparitions se font à des moments de
la chanson où la répétition est aussi musicale, ce qui accroît l'idée d'un
galop sans fin du cheval et la course de ce prince qui jamais n'arrivera à
destination. Pour renforcer cette idée on peut remarquer aussi que le cheval  n'avance
pas, mais fait du sur place (la fumée en arrière plan reste immobile). La caméra n'est
donc pas en travelling latéral mais en plan
fixe, et amorce même à un moment un zoom arrière. Ainsi non seulement on ne
peut que ressentir la quête vaine du prince, mais également jouir de la
fluidité de sa course, de la beauté de cette image irréelle en
contre-plongée. Grâce à tout cela Laurent Boutonnat côtoie au plus près ce
qu'est le cinéma expérimental : la prise de vue d'éléments à demi réels
afin de les employer dans de nouvelles formes plastiques, et inventer du même
coup une grammaire cinématographique différente qui provoque chez le
spectateur des sensations nouvelles qu'il ne peut éprouver par le biais du
cinéma traditionnel.
n'avance
pas, mais fait du sur place (la fumée en arrière plan reste immobile). La caméra n'est
donc pas en travelling latéral mais en plan
fixe, et amorce même à un moment un zoom arrière. Ainsi non seulement on ne
peut que ressentir la quête vaine du prince, mais également jouir de la
fluidité de sa course, de la beauté de cette image irréelle en
contre-plongée. Grâce à tout cela Laurent Boutonnat côtoie au plus près ce
qu'est le cinéma expérimental : la prise de vue d'éléments à demi réels
afin de les employer dans de nouvelles formes plastiques, et inventer du même
coup une grammaire cinématographique différente qui provoque chez le
spectateur des sensations nouvelles qu'il ne peut éprouver par le biais du
cinéma traditionnel.

 son.
Ainsi le serpent ne peut apparaître que sur le violoncelle du pont musical,
tant les sinusoïdes dessinées par son corps matérialisent plastiquement et
simultanément la musicalité sonore; les saccades de batterie ne peuvent
également correspondre qu'à la danse tribale de la chanteuse les cheveux
remplis de poussière, éclairées par des éclairs lumineux qui la laissent
deviner par le spectateur par flashs plus qu'ils ne la montrent. Même chose
pour le fameux travelli
son.
Ainsi le serpent ne peut apparaître que sur le violoncelle du pont musical,
tant les sinusoïdes dessinées par son corps matérialisent plastiquement et
simultanément la musicalité sonore; les saccades de batterie ne peuvent
également correspondre qu'à la danse tribale de la chanteuse les cheveux
remplis de poussière, éclairées par des éclairs lumineux qui la laissent
deviner par le spectateur par flashs plus qu'ils ne la montrent. Même chose
pour le fameux travelli ng sur
Mylène Farmer qui laisse découvrir en levant la tête des yeux vides : les
violons graves dénoncent musicalement parfaitement la monstruosité de ce
visage, alors que le piano du début en glorifiait sa beauté. Le mouvement de
caméra (qu'on appelle travelling mécanique avant) maintes fois répété au
début de la chanson sur le visage de l'interprète est ici répété encore; et
c'est précisément ce mouvement de caméra qui rend horrible la vue de ce
visage au yeux vides. Laurent Boutonnat se sert de la structure du clip-type
(qui veut que l'interprète soit toujours à son avantage, voire déifiée) pour
ensuite imposer par le même cadrage un contrepoint qui glace le sang.
ng sur
Mylène Farmer qui laisse découvrir en levant la tête des yeux vides : les
violons graves dénoncent musicalement parfaitement la monstruosité de ce
visage, alors que le piano du début en glorifiait sa beauté. Le mouvement de
caméra (qu'on appelle travelling mécanique avant) maintes fois répété au
début de la chanson sur le visage de l'interprète est ici répété encore; et
c'est précisément ce mouvement de caméra qui rend horrible la vue de ce
visage au yeux vides. Laurent Boutonnat se sert de la structure du clip-type
(qui veut que l'interprète soit toujours à son avantage, voire déifiée) pour
ensuite imposer par le même cadrage un contrepoint qui glace le sang.

 Laurent Boutonnat, de 1985 à 1992 n'a pas fait de clips. Il a fait des films de
cinéma, référencés à des genres ou des sous-genres. Mais à aucun moment,
ni même pour Ainsi soit-je ni pour Je t'aime mélancolie,
nous avons eu à faire à un vidéo-clip "digne de ce nom". A la base,
un vidéo-clip consiste à illustrer une chanson par des images. Rien de plus.
Laurent Boutonnat a toujours apposé à cette règle sans cesse davantage
d'artifices, d'histoires, de symboles... De Pardonne-moi en revanche il
fait un vrai clip stricto-sensus : une musique - des images qui l'illustrent. Le
sens des images, leur teneur discursive, tout ceci n'a aucune importance face à
leur musicalité intrinsèque et l'effet qu'elles produisent quand on les appose
à la bande-son en question. Dans Pardonne-moi plus que jamais, l'image
ne peut être présente à l'écran que parce
Laurent Boutonnat, de 1985 à 1992 n'a pas fait de clips. Il a fait des films de
cinéma, référencés à des genres ou des sous-genres. Mais à aucun moment,
ni même pour Ainsi soit-je ni pour Je t'aime mélancolie,
nous avons eu à faire à un vidéo-clip "digne de ce nom". A la base,
un vidéo-clip consiste à illustrer une chanson par des images. Rien de plus.
Laurent Boutonnat a toujours apposé à cette règle sans cesse davantage
d'artifices, d'histoires, de symboles... De Pardonne-moi en revanche il
fait un vrai clip stricto-sensus : une musique - des images qui l'illustrent. Le
sens des images, leur teneur discursive, tout ceci n'a aucune importance face à
leur musicalité intrinsèque et l'effet qu'elles produisent quand on les appose
à la bande-son en question. Dans Pardonne-moi plus que jamais, l'image
ne peut être présente à l'écran que parce que c'est CETTE chanson qui est illustrée, alors qu'on peut aisément imaginer
les images de Libertine, Sans Contrefaçon et même Ainsi soit-je
sur une autre musique de couleur approximativement équivalente. Ces images
n'ont été inventées que parce qu'il y avait tel ou tel son dans la chanson,
ces images sonnent juste par rapport aux effets musicaux tout simplement, et
ceci pour la première fois chez Boutonnat. Tout ceci pour dire que Laurent
Boutonnat a continué d'évoluer dans sa manière d'appréhen
que c'est CETTE chanson qui est illustrée, alors qu'on peut aisément imaginer
les images de Libertine, Sans Contrefaçon et même Ainsi soit-je
sur une autre musique de couleur approximativement équivalente. Ces images
n'ont été inventées que parce qu'il y avait tel ou tel son dans la chanson,
ces images sonnent juste par rapport aux effets musicaux tout simplement, et
ceci pour la première fois chez Boutonnat. Tout ceci pour dire que Laurent
Boutonnat a continué d'évoluer dans sa manière d'appréhen der
le vidéo-clip, même si ça n'est pas dans la même direction que le public
"pour lequel" il travaille. Le seul travail du réalisateur concerne
l'image, et rien qu'elle, Boutonnat n'est pas un romancier, pas plus qu'un
conteur. Quelle meilleure définition donner à sa recherche autour de la
composition de l'image que la réponse qu'il apporte dans Les Mots avec
tout son travail autour du Radeau de la Méduse, le tableau de Géricault
? Depuis 1997, de Mon Ange à Pardonne-moi en passant par Baïla
Si et Les Mots, Laurent Boutonnat n'a cessé de tâtonner pour
trouver ce qu'était vraiment un clip, ce qu'était vraiment une image, et donc
ce qu'est réellement le cinéma.
der
le vidéo-clip, même si ça n'est pas dans la même direction que le public
"pour lequel" il travaille. Le seul travail du réalisateur concerne
l'image, et rien qu'elle, Boutonnat n'est pas un romancier, pas plus qu'un
conteur. Quelle meilleure définition donner à sa recherche autour de la
composition de l'image que la réponse qu'il apporte dans Les Mots avec
tout son travail autour du Radeau de la Méduse, le tableau de Géricault
? Depuis 1997, de Mon Ange à Pardonne-moi en passant par Baïla
Si et Les Mots, Laurent Boutonnat n'a cessé de tâtonner pour
trouver ce qu'était vraiment un clip, ce qu'était vraiment une image, et donc
ce qu'est réellement le cinéma.

 Pourquoi me dira t-on, se cantonner au même type d'image, aux mêmes éléments
alors que le réalisateur a su pourtant diversifier ses inspirations en une décennie
de clips autrement plus riches ? Puisque visiblement Laurent Boutonnat s'est
(définitivement ?) détaché du cinéma pour se concentrer entièrement à ce
qu'est un clip, le réalisateur a été touché par le même syndrome que les
autres réalisateurs abordant un certain âge : faire le meilleur film, et dans
notre cas, le meilleur clip, le clip ultime. Alors que Chaplin tentait à la fin
de sa carrière de toucher cette perfection en tournant Monsieur Verdou (1953),
Tandis que
Pourquoi me dira t-on, se cantonner au même type d'image, aux mêmes éléments
alors que le réalisateur a su pourtant diversifier ses inspirations en une décennie
de clips autrement plus riches ? Puisque visiblement Laurent Boutonnat s'est
(définitivement ?) détaché du cinéma pour se concentrer entièrement à ce
qu'est un clip, le réalisateur a été touché par le même syndrome que les
autres réalisateurs abordant un certain âge : faire le meilleur film, et dans
notre cas, le meilleur clip, le clip ultime. Alors que Chaplin tentait à la fin
de sa carrière de toucher cette perfection en tournant Monsieur Verdou (1953),
Tandis que Tati retentait le
film parfait avec Traffic (1972), Laurent Boutonnat rétrécit également
de clip en clip le champ d'application de son univers afin visiblement de
trouver l'image juste, celle qui broiera la chair de celui qui la regardera. De plus
en plus on peut avoir l'idée de ce à quoi ressemblera LE clip de Laurent
Boutonnat : de longs plans contemplatifs représentant des éléments immobiles,
un ciel nuageux, du vent, des fantômes pas encore entrés dans l'au delà et se
frottant encore aux humains, une quête sans fin (que ce soit en cheval, à pied
ou en radeau) et une errance éternelle de personnages perdus et auxquels il ne
reste que le recueillement. Seulement il ne faut pas l'attendre ce fameux
dernier clip de Laurent Boutonnat, il n'y aura point de bouquet final, rien ne
le distinguera particulièrement des autres, ce sera juste celui sur lequel le
cinéaste voudra s'arrêter, estimant achevée la recherche qu'il fait sur
l'image et avant tout sur ses propres fantasmes graphiques. Pardonne-moi
aurait pu d'ailleurs être celui-ci, le seul vrai clip, donc le dernier. Et si ce
n'est pas le cas, un cap a de toute façon été franchi en le réalisant : se désintéresser
intégralement de tout fonctionnement narratif pour ne se concentrer que sur
l'image, quitte à ce qu'elle rende ivre tellement sa beauté ne renvoie à rien
de connu.
Tati retentait le
film parfait avec Traffic (1972), Laurent Boutonnat rétrécit également
de clip en clip le champ d'application de son univers afin visiblement de
trouver l'image juste, celle qui broiera la chair de celui qui la regardera. De plus
en plus on peut avoir l'idée de ce à quoi ressemblera LE clip de Laurent
Boutonnat : de longs plans contemplatifs représentant des éléments immobiles,
un ciel nuageux, du vent, des fantômes pas encore entrés dans l'au delà et se
frottant encore aux humains, une quête sans fin (que ce soit en cheval, à pied
ou en radeau) et une errance éternelle de personnages perdus et auxquels il ne
reste que le recueillement. Seulement il ne faut pas l'attendre ce fameux
dernier clip de Laurent Boutonnat, il n'y aura point de bouquet final, rien ne
le distinguera particulièrement des autres, ce sera juste celui sur lequel le
cinéaste voudra s'arrêter, estimant achevée la recherche qu'il fait sur
l'image et avant tout sur ses propres fantasmes graphiques. Pardonne-moi
aurait pu d'ailleurs être celui-ci, le seul vrai clip, donc le dernier. Et si ce
n'est pas le cas, un cap a de toute façon été franchi en le réalisant : se désintéresser
intégralement de tout fonctionnement narratif pour ne se concentrer que sur
l'image, quitte à ce qu'elle rende ivre tellement sa beauté ne renvoie à rien
de connu.
Jodel Saint-Marc.
